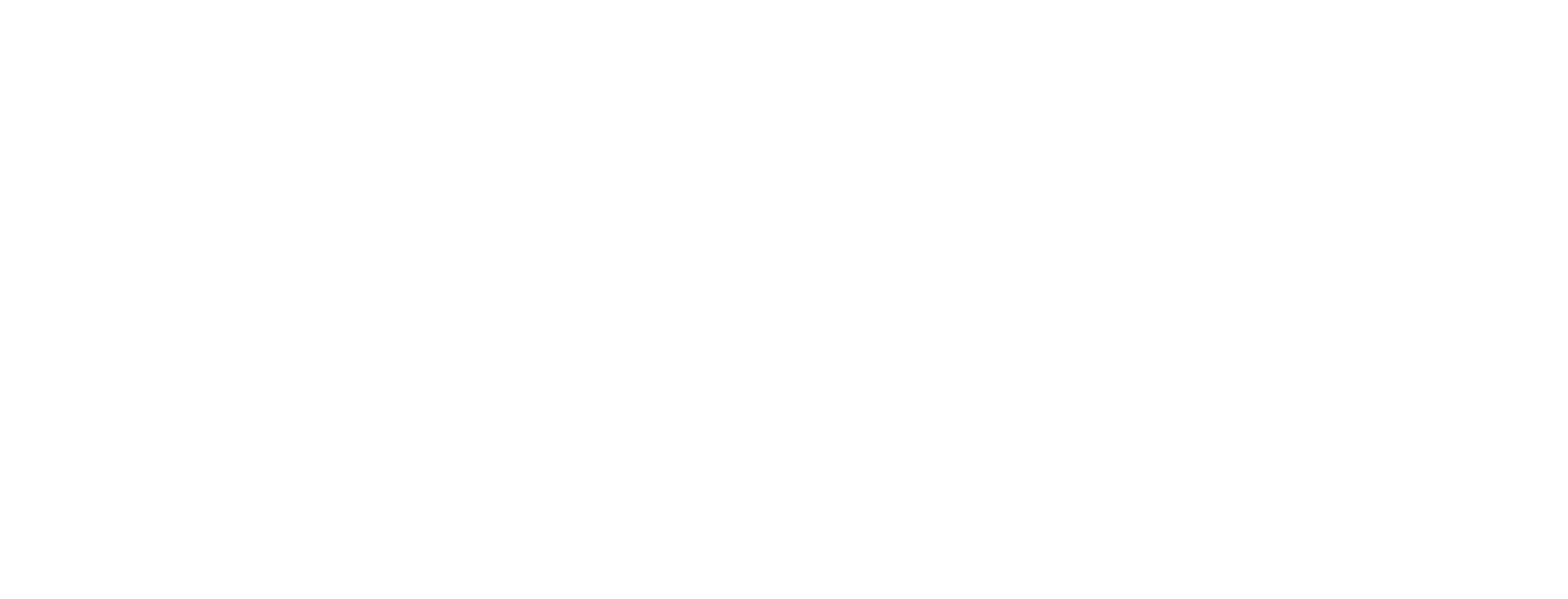Contribution des transporteurs fluviaux à la mission relative à la logistique urbaine
Suite à la première réunion du Comité interministériel de la logistique (Cilog) qui s’est tenu en décembre 2020, le Gouvernement a confié à Anne-Marie Idrac, Jean-Jacques Bolzan et Anne-Marie Jean, une mission relative à la logistique urbaine qui doit contribuer à une stratégie nationale pour une logistique urbaine durable. Dans ce cadre, E2F a mis en place un groupe de travail « Logistique urbaine durable » afin de préparer la contribution de la Fédération à la mission gouvernementale. Vous trouverez ci-dessous la contribution qu’E2F a fait parvenir au gouvernement.
La massification des envois que permet la capacité d’emport du transport fluvial réduit le nombre de véhicules en circulation et en stationnement, les nuisances sonores, les risques d’accident sur la voirie, et la consommation d’énergie. C’est pourquoi, depuis la prise de conscience de la nécessité de concilier les objectifs du développement durable et de l’urgence climatique, le report modal de la route vers le fleuve apparaît comme une des solutions pour réduire les nuisances des transports, y compris dans le cadre de l’organisation d’une logistique urbaine.
Sauf exceptions, le maillon fluvial du transport de marchandises s’inscrit dans une chaîne logistique plus étendue, qui nécessite une ou plusieurs ruptures de charge ; par exemple, il peut y avoir un transport routier avant le transport fluvial, et un transport routier après le transport fluvial. Ainsi, la rentabilité de la chaîne logistique tout entière implique une solidarité incontournable entre le coût de revient du segment de transport fluvial et le coût de revient des pré/post-acheminements, auxquels s’ajoutent les coûts de manutention portuaire.
La logistique urbaine ne se limite pas au transport de biens de grande consommation sous forme conditionnée.
La logistique urbaine fluviale est une logistique déjà ancienne mais qui concerne le plus souvent les produits en vrac. A paris, près de 20 % des échanges de marchandises sont opérés par le fleuve ce qui rend pour la capitale le transport fluvial vital.
Schématiquement, 4 catégories de marchandises se transportent en ville par le fleuve, leur conditionnement influe sur la chaîne de valeur et l’organisation logistique :
- les envois de marchandises en vrac, comme par exemple les granulats pour la fabrication du béton, les déchets du BTP, les produits pétroliers, le mâchefer ;
- les envois de conteneurs maritimes, de caisses mobiles, de conteneurs autres (déchets) ;
- les envois de marchandises autres : marchandises sur palettes (marchandises emballées, en cartons, en fûts, en sacs, ou non emballées, comme des parpaings), marchandises encombrantes, des colis, etc. Les colis générés par le commerce électronique entrent dans cette catégorie ;
- les automobiles (neuves, hors d’usage et utilitaires légers) et leurs pièces détachées
Les marchandises en vrac constituent un fret traditionnel pour le transport fluvial. En général, les granulats, les produits pétroliers, et quelques autres vracs parviennent jusqu’au cœur des grandes villes fluviales sans souci majeur, avec un trajet direct, sans escale intermédiaire, entre le point d’origine du fret et son point de livraison. L’économie de ce type de transport, via l’affrètement de barges, ne soulève pas de problèmes majeurs. Il serait sans doute possible d’augmenter le recours au transport fluvial pour ce type de fret, notamment en offrant de nouveaux quais/appontements pour la desserte des cœurs de ville, mais le risque aujourd’hui réside dans leur diminution au profit d’usages de loisir.
Les marchandises générales (produits manufacturés) ne constituent pas un fret traditionnel pour le transport fluvial, hormis celles qui sont empotées dans les conteneurs transocéaniques. Le transport de ces marchandises générales doit s’inscrire dans une organisation logistique complexe. Il n’est généralement pas possible pour les marchandises générales et produits manufacturés de substituer purement et simplement au maillon routier le maillon fluvial sans repenser entièrement l’organisation amont et aval et souvent même en repensant le maillon fluvial lui-même. Historiquement les transporteurs fluviaux faisaient valoir leur capacité à gérer de stocks flottants en cœur de ville, plus récemment certains d’entre eux ont ajouté des prestations à valeur ajoutée (Préparation de tournées à bord du bateau dans le cas de Fludis).
En effet, les caractéristiques des envois de marchandises générales obligent le transporteur fluvial à devenir un transporteur public de lignes régulières, spécialiste des lots de petites tailles. Il doit être en mesure d’offrir un service à des centaines de chargeurs différents, en réalisant le groupage technique des lots expédiés à l’intérieur d’une seule cale.
Deux obstacles se heurtent ainsi à l’opérateur fluvial, d’une part l’obstacle du modèle économique largement grevé par les ruptures de charge et de l’autre la méconnaissance d’un métier qui n’est pas le sien, celui de l’organisation logistique.
Le transport de véhicules neufs existe sur la Seine depuis les années 60. Jusqu’à 250.000 véhicules par an ont pu être transportés par la voie d’eau. La Crise de 2008 a profondément modifié cet écosystème et poussé le transport fluvial de véhicules à se réinventer en proposant des solutions pour transporter les véhicules entre les usines ou les centres logistiques et les concessions en centre-ville. Une démonstration a été faite en 2011 tendant à montrer que si les acheteurs (particuliers ou grandes entreprises) prenaient possession de leurs véhicules sur les quais, de nombreux trajets en camions pourraient ainsi être évités. Cette solution permet aussi d’évacuer du centre-ville les véhicules d’occasion et les VHU. Malheureusement les réticences des acteurs de cette filière combinées à l’existence d’une dérogation pour la circulation des porte-huit à Paris (leur surface au sol excédant les 29 m2 autorisés) ont eu raison de cette initiative. Cette activité présente néanmoins toujours beaucoup d’intérêts car les flux sont importants et la voie d’eau est en mesure d’apporter une solution technique.
Les conditions nécessaires à la compétitivité du transport fluvial
La topographie
Le tracé du fleuve (ou celui des canaux) dans l’agglomération revêt une importance non négligeable. Lorsque la voie d’eau irrigue les zones les plus densément peuplées, dotés de quais urbains facilement accessibles -ou que l’on peut rendre facilement accessibles- (à la fois côté fleuve et côté terre) et dotés de terre-pleins de tailles adaptées, les projets sont plus facilement envisageables.
La densité de la population à proximité des quais urbains joue de deux façons : elle permet d’amortir les coûts logistiques de distribution/enlèvement sur un grand nombre de clients et, comme elle contribue, entre autres, à la congestion de circulation sur les voies routières urbaines, elle incite au report du fret vers la voie d’eau. Ainsi, toute l’Île-de-France bénéficie d’une géographie physique et humaine favorable au transport fluvial. En comparaison, la ville de Strasbourg, qui tangente le fleuve, n’a pas du tout le même intérêt pour l’usage urbain du Rhin et de son affluent. Lyon et Lille seraient à classer dans une situation intermédiaire.
La même logique prévaut en amont et en aval avec des chargeurs implantés à proximité des fleuves.
Le volume de fret
La rentabilité du transport fluvial requiert une masse critique de fret, proportionnelle à la capacité d’emport de ce mode.
Par exemple, la production de béton en Île-de-France repose sur l’arrivée régulière de grandes quantités de granulats en vrac (majoritairement expédiés depuis la Normandie) débarquées sur les quais urbains de la ville de Paris et les grandes quantités de produits manufacturés expédiées des entrepôts de banlieues vers le centre de Paris (Franprix) remplissent des barges.
Les transports d’approche
Une autre condition étroitement liée à la rentabilité d’une chaîne logistique avec maillon fluvial est le transport terrestre -initial ou final- associé à une escale fluviale : un camion doit pouvoir assurer plus d’une rotation journalière à partir/vers un site portuaire. Plus le nombre de rotations quotidiennes est élevé (supérieur à 5, par exemple), plus le transport fluvial peut être pertinent.
Le transport fluvial est certes un transport de masse, mais son intérêt économique ne peut absolument pas être dissocié de celui du mode de transport qui le précède ou le suit pour constituer un transport multimodal.
Dans le même ordre d’idées, la complémentarité, au sein du réseau de transport terrestre, entre les plates-formes fluviales et les plates-formes routières ou ferroviaires, s’avère essentielle.
La disponibilité et la compétitivité du foncier
En cœur de ville
Les pouvoirs publics doivent garantir la disponibilité foncière nécessaire, mais également susciter, encourager et soutenir, sur le long terme, les projets (indépendamment de toute aide financière directe), ce d’autant plus fermement que la pression des promoteurs immobiliers sur les rives semble s’accentuer un peu partout.
La défense des installations portuaires (existantes ou à venir) commence par l’affichage de la logistique urbaine dans les documents de planification. Ainsi, les pouvoirs publics ont-ils intérêt à réserver des quais urbains pour l’accostage des barges ; ils peuvent par ailleurs, via les cahiers des charges (déchets), imposer le recours au transport fluvial. Ils peuvent également encourager les mesures d’acceptabilité, par les habitants, des installations portuaires (quai de Tolbiac, par exemple).
La constitution de hub logistiques ou d’hôtels logistiques configurés pour le fluvial pourrait faire l’objet de schémas directeurs.
Les opérateurs d’Etat que sont les ports intérieurs peuvent par le jeu des conventions d’occupation temporaire qu’elles signent avec les chargeurs favoriser le recours à la logistique fluviale par une tarification incitative : c’est actuellement le cas à Lyon et Paris.
En périphérie, le long des corridors fluviaux
La stratégie nationale portuaire publiée le 22 Janvier 2021 fixe parmi la liste de ses actions, un objectif consistant à accroître l’implantation de nouvelles activités génératrices de trafics sur les zones industrialo-portuaires dans le prolongement du rapport de l’inspection générale des finances visant la mise en place de « zones économiques spéciales » offrant aux industriels et logisticiens une fiscalité locale allégée. Il s’agit de lever les freins à l’implantation en zone industrialo-portuaire de nouvelles entreprises dans une approche de développement durable.
Dans leur rapport aux Ministres des transports et de l’Economie « Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable » Messieurs Patrick Daher et Laurent Hémar étaient encore plus explicites en demandant de :
– Diminuer les délais de constitution et d’instruction des dossiers d’autorisations administratives d’au moins 6 mois, pour les rendre équivalents à ceux de l’Europe du Nord Afin de capter, en France, des investissements dans des plates-formes logistiques, il convient que le délai global des procédures administratives (constitution du dossier et procédure administrative) soit drastiquement réduit.
– Développer une fiscalité foncière prévisible, favorisant la création et la modernisation des entrepôts et d’un montant comparable à nos voisins européens Afin que la fiscalité foncière ne soit plus un frein à l’installation ou au développement en France d’entrepôts logistiques à haute valeur ajoutée, employant un nombre important de salariés qualifiés.
Les leviers de l’action publique
Les ports
Face aux pressions du milieu urbain, il s’agit tout d’abord de préserver le foncier portuaire urbain. Les ports doivent être bien intégré au territoire, ils sont dans l’obligation de démontrer, de faire comprendre, l’utilité sociétale de leurs activités. Leur enjeu est de mobiliser les collectivités locales compétentes pour préserver et faire évoluer leurs activités au bénéfice de la collectivité et en particulier pour la préservation de leur foncier.
Pour faire face à la pénurie de terrains, certains ports commencent à mettre en place des quais à usage partagé, sortes de quais publics non amodiés à une seule entreprise permettant de recevoir des activités mixtes.
Il s’agit aussi pour les gestionnaires de voierie et aux ports de garantir l’accès aux quais et le stationnement des véhicules en bord à eau. Des mesures de régulation pourraient être introduites en autorisant les transports d’approche fluviale pour les livraisons par véhicule routier l’après-midi, plage horaire le plus souvent interdite pour tous les véhicules routiers d’une surface au sol supérieure à un seuil défini réglementairement (29 m2 à Paris).
Les ports ainsi que le gestionnaire de la voie d’eau ont la possibilité via les redevances qu’ils perçoivent d’inciter au développement des offres de logistique urbaine fluviales par :
- Une absence de péage sur le transport de conteneurs vides
- Une réduction voire une annulation des redevances aux escales
Il est essentiel de relever que les véhicules routiers qui circulent en zone dense n’ont ni à s’acquitter d’un péage ni à verser de redevances au gestionnaire de la voierie pour l’occupation au sol en service comme à l’arrêt.
En décembre 2019, la LOM a par ailleurs introduit un nouvel outil, le schéma de desserte fluviale, qui pourra être mis en œuvre à compter du 1 er janvier 2021.
La LOM crée le schéma de desserte fluviale. Il s’agit d’une possibilité pour le plan de mobilité d’intégrer ce schéma. En effet, le plan de mobilité peut intégrer un schéma de desserte fluviale (ou ferroviaire), qui identifie les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises. L’article L. 1214-2-2 du Code des transports précise que « Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. »
L’action publique peut aussi se révéler contreproductive. Ainsi, il existe des pressions fortes et récurrentes pour faire rallier les ports intérieurs à la Convention Collective Nationale Unifiée dite « Convention dockers » (La CCNU).
Ce rattachement est une revendication ancienne de la Fédération Nationale Ports et Docks (FNPD) de la CGT. Lors de sa création en 2011, son application a été limitée aux ports maritimes. Néanmoins, l’objectif du syndicat est d’y rallier à terme les personnels des ports intérieurs, des ports de pêche et ceux des ports de plaisance. Le sujet est revenu sur le devant de la scène dès 2018 à l’occasion du projet Haropa.
La perspective de voir le Port de Paris, un port intérieur, de fait fusionné à deux ports maritimes, Le Havre et Rouen, a conforté la CGT dans cette revendication et le sujet revêt maintenant une dimension nationale.
Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, Ministre chargé des transports a confié le 4 Septembre 2020 à Maître Gilles Bélier, par ailleurs membre de la mission de préfiguration du projet Haropa, une mission dont les conclusions doivent lui être remises le 31 décembre 2020, afin d’expertiser les différentes options de restructurations envisageables en dégageant leurs avantages et limites.
Si la convention docker était étendue aux ports intérieurs, elle provoquerait avec certitude le déclin des activité économiques qui y sont exercées par le renchérissement considérable des opérations de manutention et de logistique qui y sont exercées.
La planification
Organisation ou contribution au développement de services de transports de marchandises et de logistique urbaine en cas de « défaillance » de l’offre privée.
La loi d’orientation des mobilités vient préciser l’apport de la Loi MAPTAM sur l’organisation des services de transport de marchandises et de logistique urbaine (cf. chapitre 3 de cet ouvrage), c’est pourquoi l’article L1231-1 du Code des transports change de numéro et devient l’article L 1231-1-1 du Code des transports. En effet, cet article L 1231-1-1 précise que « dans son ressort territorial », chacune des autorités organisatrices de la mobilité (ainsi que la région dans le cas où elle intervient en tant qu’AOM) peuvent (en plus de leurs compétences obligatoires) « organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire 10 congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement». La LOM est donc plus précise que la loi MAPTAM, elle ajoute les termes d’inexistence » et « d’insuffisance » de l’offre privée, alors que la loi MAPTAM faisait exclusivement référence à l’inadaptation de cette offre. Et surtout, si elles n’organisent pas elles-mêmes directement ces services de transports de marchandises et de logistique urbaine, les AOM ont la possibilité de contribuer à ces services.
Les amodiations et la réglementation
Les critères de report modal dans les amodiations des terrains en bord de voie d’eau sont un excellent levier. Force est de constater que dans certains cas les amodiataires préfèrent souffrir un loyer majoré que de mettre en œuvre une solution de report modal qui leur permettrait de réduire ce loyer. Il y a donc probablement des marges de progrès à exploiter sur cet aspect.
Le transport routier de véhicules bénéficie d’une dérogation pour l’utilisation de camions porte-huit dont la surface au sol excède largement les 29 m2 autorisés. Cette dérogation permanente empêche le transport fluvial de proposer des solutions alternatives compétitives d’un point de vue économique.
On peut aussi noter le cas de l’Île-de-France (article LI 241-1), l’établissement public dénommé « Île- de-France Mobilités » en tant qu’autorité compétente, organise « des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation ». « Île-de-France Mobilités » peut organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.
La commande publique
Les personnes morales de droit public comptent aujourd’hui parmi les principaux donneurs d’ordre en matière de transport de marchandises par le biais de leurs achats et marchés publics.
Ces achats se portent majoritairement vers la construction, le traitement et la valorisation des déchets, dont les transports génèrent de fortes émissions de GES, non comptabilisées à ce jour et par conséquent non maîtrisées.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit pourtant une mobilisation du secteur public en matière d’éco-responsabilité. La loi fixe de nouvelles obligations à l’État et ses établissements et opérateurs en matière d’achat ou de fonctionnement interne ou impose des objectifs nationaux à tous, appelant à un Etat exemplaire. Ces obligations couvrent des domaines tels que la rénovation des bâtiments, les produits phytosanitaires ou l’économie circulaire… Aucune de ces obligations ne couvre le transport de marchandises amont et aval qu’implique les achats effectués par les personnes morales de droit public. L’examen prochain du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets permettrait de corriger cette omission.
La prise en compte des externalités
Les certificats d’économie d‘énergie (C2E). Le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) permet de financer partiellement les investissements générant des économies d’énergie, soit par les consommations énergétiques évitées par les trafics fluviaux par rapport à la route, soit par l’installation d’équipements qui optimisent les consommations énergétiques d’une unité fluviale. Ces aides sont octroyées par les énergéticiens et distributeurs d’énergies.
Ce dispositif permet de valoriser financièrement des économies d’énergie réalisées sur des opérations standards dans les domaines de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture mais aussi du transport.
Il s’appuie sur une obligation des énergéticiens et distributeurs de carburant de réaliser et faire réaliser des économies d’énergie grâce à des investissements adéquats (ils sont appelés les “obligés”).
Entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2020, les CEE délivrés pour des opérations standardisées et spécifiques représentent moins de 5 % pour le secteur des transports (4,3 %).
Aujourd’hui, il existe 32 fiches CEE standardisées pour le secteur des transports dont 8 fiches pour le transport fluvial, mais aucune ne concerne la logistique urbaine.
L’écotaxe. Un rapport sur la mobilité en grande couronne d’Ile-de-France appelle à instaurer une taxation des camions pour financer « un plan Marshall des mobilités ».
L’idée refait surface dans un rapport sur l’avenir de la mobilité en grande couronne d’Ile-de-France ainsi que le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
François Durovray, président LR du conseil départemental de l’Essonne, auteur du rapport avec sept parlementaires affirme vouloir un plan d’investissement massif et spécifique pour la grande couronne, un plan Marshall des mobilités.
En complément de cette contribution écrite, E2F a fait parvenir un certain nombre d’exemples illustrés de logistique fluviale urbaine sur tout le territoire français.