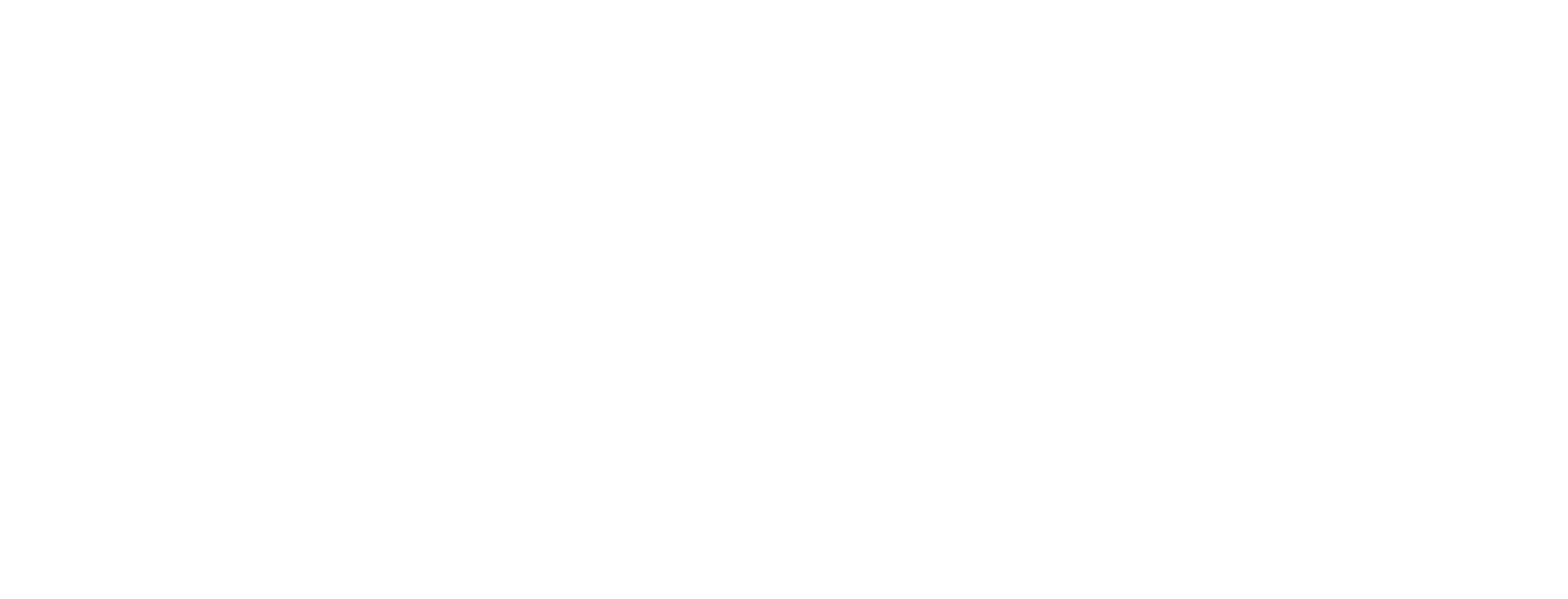Accident du pont de Sully : ce qu’il nous apprend
À la veille des travaux de reconstruction des deux arches du pont de Sully à Paris, endommagés en janvier, Didier Leandri, président délégué général d’E2F fait le point sur le dossier.
Quelles sont conséquences de l’accident du pont de Sully pour les activités de navigation dans Paris ?
Survenu fin Janvier à la suite du heurt d’un bateau à Passagers, l’accident du pont de Sully a entrainé de fortes restrictions à la navigation pour la traversée de Paris, avec seulement deux possibilités de passage par jour pour les plus gros bateaux.
De fait, depuis 4 mois les transporteurs n’ont plus la possibilité de naviguer H24 sur le réseau à grand gabarit.
Navigants et chargeurs ont dû adapter leur organisation, avec des contraintes horaires extrêmement fortes pour le fret, la logistique urbaine et la privatisation.
Entre heures de nuit à répétition, perte de chiffre d’affaires et de réputation vis-à-vis des chargeurs, les transporteurs s’apprêtent à sortir affaiblis de cette épreuve.
Selon vous ces restrictions étaient-elles justifiées ?
Tout a été dit sur ce sujet. Nous croyons chez E2F qu’il a été fait un usage excessif du principe de précaution. Les transporteurs se sont adaptés bon gré mal gré et ont été patients, probablement trop.
Les travaux de reconstruction vont démarrer en juin, pourquoi si tard ?
Nous ne l’expliquons pas sauf à intégrer la contrainte que représentent les JOP2024 et les répétitions de la parade qui ont amené à des atermoiements de la Ville de Paris, dont je rappelle qu’elle a la responsabilité du pont. La question s’est longtemps posée de savoir s’il fallait reconstruire le pont avant ou après les JO.
Quoiqu’il en soit, ces travaux interviennent au plus mauvais moment de l’année pour le transport fluvial, qui connaîtra en juin une forte activité du tourisme et du fret.
Quel premier bilan dressez-vous de ce dossier ?
Ce dossier est de notre point de vue emblématique du traitement réservé au transport fluvial en France.
L’absence de célérité dans ce dossier montre à quel point les intérêts du fleuve sont considérés comme secondaires au sens de non stratégiques par un certain nombre de parties prenantes. Jamais dans aucun pays fluvial qu’il s’agisse de la Belgique, des Pays Bas ou de l’Allemagne une telle durée n’aurait été tolérée.
Les adaptations permanentes des horaires de passage et restrictions montrent une deuxième chose : le processus de concertation avec les navigants et leurs représentants sur les conditions opérationnelles de navigation en mode dégradé ne sont pas adaptées. Consultée systématiquement au dernier moment, jamais intégrée aux réunions techniques préalables et phases d’instruction amont, la Profession a subi les décisions sans pouvoir y prendre part pleinement et les navigants étaient informés sans préavis.
Pour Sully, ceci a conduit à devoir quasiment systématiquement « corriger le tir » après coup.
Le Règlement Particulier de Police (RPP) de Paris n’est pas à jour, comme sur d’autres bassins et ne laisse que peu de marge de manœuvre pour opérer en mode dégradé lorsque survient un accident et permettre d’assurer la continuité de la navigation.
Cette situation doit interpeller les acteurs pour que des changements profonds soient opérés car le paradoxe c’est que la mobilisation des opérateurs de l’Etat, VNF et Haropa Port de Paris n’a pas manquée d’être exceptionnelle dans ce dossier.